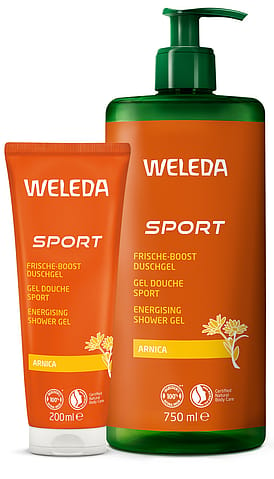Tout est dans la structure.
Comment l’arnica régénère les tissus lésés.
Les inflorescences de l’arnica se distinguent par toute une série d’atouts. Près de 150 composants à usage pharmaceutique ont pu être identifiés à ce jour. Les substances les plus puissantes et les plus connues sont sans doute les flavonoïdes, caroténoïdes, lactones sesquiterpéniques et, bien sûr, les précieuses huiles essentielles. Sa fine teneur en acide silicique confère à l’arnica des forces structurantes et formatrices, qui aident le corps à régénérer les tissus, par exemple en cas d’hématomes, de contusions et de meurtrissures. Dans ce genre de lésions traumatiques, la surface de la peau reste en général intacte, mais les structures sous-jacentes ont été endommagées. Les extraits d’arnica favorisent la circulation sanguine. Ils ont un effet anti-inflammatoire, antiseptique et structurent le métabolisme. Cela soulage les douleurs et accélère la guérison.
Entrée en scène tardive, gros succès.
L’histoire de l’arnica.
L’arnica a débuté sa « carrière » comme plante médicinale appréciée relativement tard. Les textes anciens ne contiennent aucune indication quant à ses nombreuses vertus. L’arnica trouve sans doute sa première mention chez Hildegarde de Bingen, célèbre érudite du Moyen-(Âge. Elle parle d’une plante du nom de « Wolfsgelegena », qui désigne probablement l’arnica. Depuis le XVIIIe siècle, l’arnica a volontiers été employée pour traiter différents maux. On a essayé de l’utiliser contre la goutte et les rhumatismes, les varices et les inflammations des veines. Elle était même censée agir comme analeptique* et stimulant général. Aujourd’hui, l’arnica aide principalement en usage externe, en cas de douleurs musculaires ou articulaires et de lésions traumatiques. L’efficacité de cette « plante médicinale de l’année 2001 » a été vérifiée à de multiples reprises et certifiée au niveau clinique.